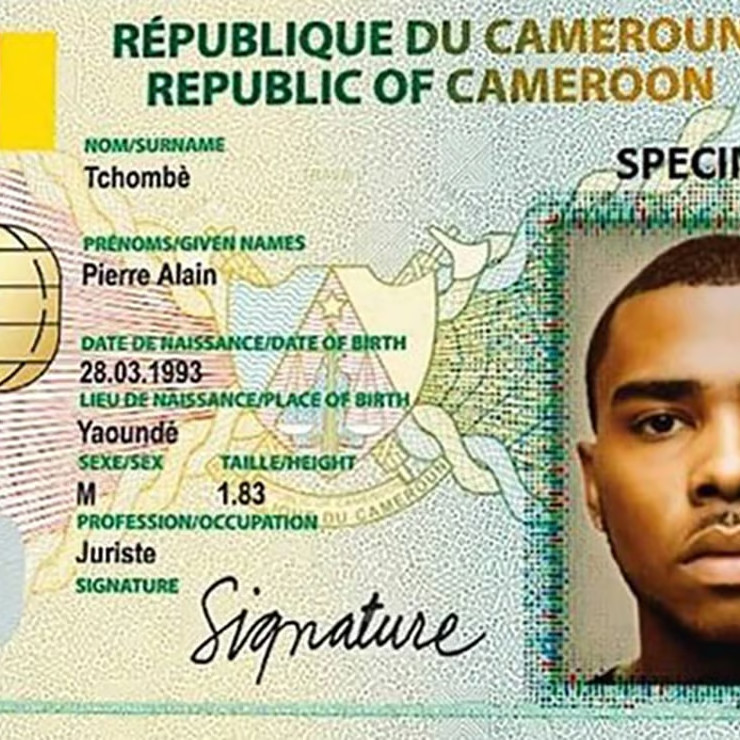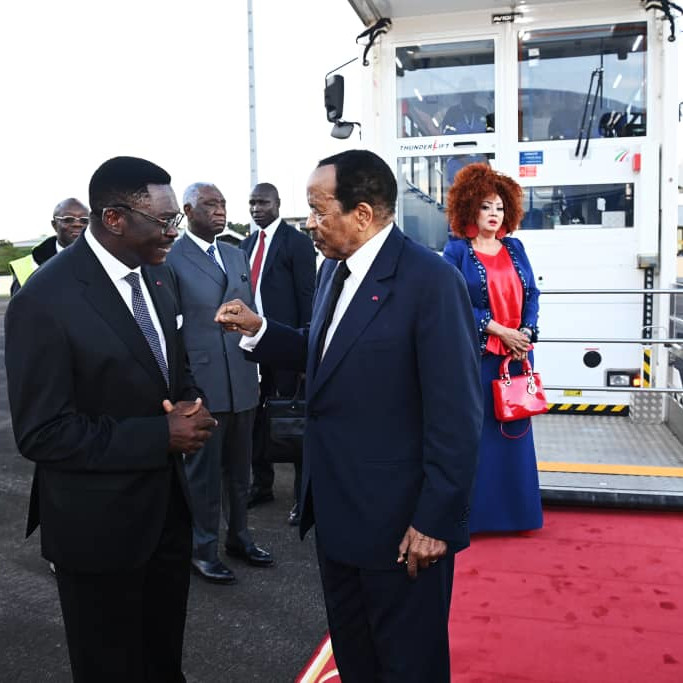-
© kamerkongossa : Florian Ngimbis
- 20 Nov 2019 09:20:00
- |
- 11014
- |
CAMEROUN :: Ce jour où je suis mort dans un lit de l’hôpital central de Yaoundé :: CAMEROON
L’actualité récente, celle d’un médecin bastonné à l’hôpital d’Efoulan par les parents d’un patient m’a rappelé une histoire personnelle. Oh oui, dans ce pays, quand on parle d’hôpital et de santé en général, chacun a une petite histoire à raconter. Rarement drôle, hélas.
Il y a plusieurs années, alors étudiant à l’ESSTIC de Yaoundé, je rentre d’un long séjour en France. Suite au tapage médiatique lié à mon séjour outre-mer, tout mon quartier sait que le petit Ngimbis a percé, information qui tombe fatalement dans les oreilles des brigands locaux.
Le lendemain de mon retour, 2h du matin. Un fracas me réveille. Noyé dans le brouillard cotonneux du sommeil interrompu, je ne réalise pas tout de suite ce qui se passe. Mais à la lueur diffuse de ma lampe de chevet, je vois briller le tranchant affûté d’une machette : un braquage.
Ils sont deux. Tandis que le premier me tient en respect avec sa machette, le second s’empare de tout ce qui à ses yeux a de la valeur. Debout sur mon lit, nu, les bras à la verticale, je suis la scène avec détachement, presque pressé de me recoucher, quasi indifférent à ce qui se passe sous mes yeux.
Le « collecteur » achève sa besogne et disparaît dans la nuit. C’est à ce moment que les choses dérapent. Pour une raison inconnue, le second arsouille, celui qui me tient en respect avec son instrument de mort me feinte. Je recule. Seconde feinte. Quelque chose dans mon esprit me souffle que ça n’en est pas une. Je recule encore, mais le mur est là. Impossible d’aller plus loin. Je fais face. Comme dans les films chinois des années 80, je lève l’avant-bras droit pour parer le coup que je sens venir et qui vise mon épaule. Je me rappelle de la sensation, comme une légère décharge électrique.
Zwak!
Le type se sauve.
Je soupire et me rends dans le salon pour constater les dégâts. C’est là, tandis que je contemple ma porte éventrée, que je constate que le mur sur lequel je suis appuyé, initialement blanc, est en train de virer au rouge, comme maculé par les coulées de peinture d’un plasticien paresseux.
Je baisse les yeux et toute l’horreur de ma situation m’apparaît. Je viens de recevoir un coup de machette. L’arme a décrit un arc de cercle autour de mon avant-bras, me tranchant les tendons supérieurs au passage, puis a ricoché sur les os, avant de poursuivre sa course sur mon pectoral droit qui lui aussi est ouvert.
Je hurle. Un cri de bête blessée. La douleur en profite pour s’installer.
Les voisins accourent enfin. Ma sœur et mon frère, également étudiants à l’époque et voisins d’appartement sont aussi là. La confusion règne. La vue du sang qui coule en abondance trouble les esprits. Entre deux sanglots, je suggère d’appeler les secours, un ricanement jaune succède à la suggestion.
Mon gars, tu es toujours en France dans ta tête hein.
Mon frère, plus pragmatique suggère l’hôpital d’Efoulan, voisin de deux cent mètres. Je perds trop de sang. Ma sœur pleure en m’enfilant un jean pour cacher ma nudité que je n’ai même pas remarquée.
C’est là que surgit celui à qui je dois probablement la vie. Mbarga Marcel, alors étudiant en médecine, aujourd’hui praticien, un jeune voisin qui à l’époque fréquentait plus les bars que les amphis (je mens ?)
« Père » comme on l’appelle dans le quartier parvient à arrêter partiellement l’hémorragie en usant de ma main comme point de compression sur la blessure. Je sens mes doigts glisser dans la plaie, j’entrevois le nacre de mes os. Mais je saigne toujours du pectoral.
Je me souviens à peine du trajet entre mon domicile et les urgences de l’hôpital. Père et mon frère me portent littéralement. Je suis au bord de la perte de conscience.
Hôpital d’Efoulan, alors dans son ancienne configuration, celle d’avant la construction du bâtiment à étages en face. Le vigile enfermé dans sa guérite maintient le portail clos. Sans ouvrir ni jeter un regard, il pose, un tas de questions sur nos identités et les motifs de cette « visite » tardive.
Ma sœur perd patience et tape un grand coup dans la porte. Il daigne se lever et en découvrant mon état, ouvre sans autre commentaire. Je suis torse nu. Mon pectoral est béant et laisse échapper un flot de sang. Mon bras est un objet sanguinolent qui ne m’appartient plus, replié en forme de crochet, que je n’ai même plus la force de tenir. Mon jean bleu est noir de mon sang.
Il nous indique les « urgences ».
Une femme y somnole emmitouflée dans un pull, Croc’s et bas de laine aux pieds.
Madame !
Elle sursaute. Nous observe, mal réveillée,
Il y a quoi ?
Père lui brosse la situation en quelques phrases, des phrases dont la seule utilité sera probablement d’alimenter la gazette de kongossa local qu’elle tient avec ses collègues de service le jour. Ma cooo je te dis que hein… Le genre de bandit qu’on a alors amené ici cette nuit hein… Je te jure ma copine, ils cachaient, mais j’ai bien vu que c’était la justice populaire. De fait, elle me regarde comme un pestiféré et sans m’ausculter, sans me toucher, elle lance, en tapant dans les mains :
Pardon! Pardon! On ne gère pas le genre de cas-là ici. Il faut aller au CHU ou à l’hôpital central.
Seconde de flottement. On croit avoir mal entendu. La suite m’apparaît comme un rêve éveillé. L’engueulade avec mon frère qui veut lui sauter dessus, ma sœur traumatisée qui n’arrive plus à parler, et Père qui essaye de me relever. Nous demandons au vigile s’il y a une ambulance disponible. Il secoue la tête. Nous revoici dans la rue. Je saigne à nouveau du bras. La trainée brillante est bien visible sur le bitume. Père improvise un garrot avec son t-shirt. Je suis de plus en plus faible et je lutte pour rester conscient. Il m’applique des petites gifles en m’exhortant à ne surtout pas m’endormir.
J’ai peur, mais je pense à Socrate : nul ne sait ce qui se passe après la mort, il est donc insensé de craindre ce que l’on ne sait pas. Mon cœur qui fait des toup toup terrorisés dans ma poitrine n’est pas du même avis. Nous sommes tous les quatre étudiants, personne n’est proprio d’une voiture. Il va falloir trouver un taxi, ce qui n’est pas une mince affaire à Efoulan, à presque trois heures du matin.
Mais mes ancêtres veillent cette nuit-là. Sorti de je ne sais où, un véhicule jaune répond à notre sollicitation. A ma vue, le chauffeur se rebiffe. Il ne veut pas salir ses sièges. Mon frère double le prix de la course et étale son t-shirt sur le siège pour limiter la pollution. J’ai mal. Une douleur terrible qui me fait pleurer en silence. J’ai peur de regarder mon bras et cette main recroquevillée qui ne m’obéit plus.
Les rues sont heureusement vides et nous voici à l’hôpital central, urgences chirurgicales. Je ne me souviens pas de grand-chose, juste de m’être retrouvé dans une salle pleine de râles et de gémissements. Je me souviens des gens par terre, de l’odeur, de la terreur qui m’a submergé. Doté d’une constitution vigoureuse, je n’avais depuis ma circoncision eu aucune raison de retourner à l’hôpital. Ma vision de ce lieu était celle façonnée par les séries américaines dont je me gavais. Un lieu de douleur certes, mais accueillant, aseptisé. Je suis frappé par le contraste entre cette chimère et la réalité de ces locaux désuets, surpeuplés, froids, presque sales.
Je suis quasi livré à moi-même. Les voiles noirs qui obscurcissent ma vue sont de plus en plus récurrents et je réprime difficilement l’envie de m’assoupir. La suite est un patchwork d’images que je peine à mettre en ordre :
Je me souviens de Père, en short et maillot de corps ensanglantés, courant vers l’équipe de médecins de garde. Je me sens transporté dans un lit froid.
Je l’entends m’expliquer que ce sont ses camarades de fac, qu’ils vont s’occuper de moi. Je me souviens de leurs têtes penchées sur moi, alors que je me demande si ce sont des acteurs ou de vrais médecins, tellement ils font jeune. Ordonnances, mon frère qui court payer. Je revois la perfusion, me souviens m’être demandé quand on me l’a posée.
Je me souviens de l’entrée de ce médecin grand, à l’air sévère. Il ausculte mon bras, parle de radio, d’os probablement brisé. Nettoie le sang sur ma poitrine, parle de recoudre. Je me souviens de l’aiguille vrillée dans ma chair à vif. Il me recoud. Me gronde parce que je crie. J’ai honte d’être incapable de me retenir. Je suis maintenu dans le lit par deux bras vigoureux qui limitent mes spasmes de douleur. A cette occasion, j’ai appris qu’un des barèmes de la douleur est la température des larmes. Je suis silencieux, mais mes larmes sont presque brûlantes.
Aïe ma mère, qu’est-ce que j’ai mal. Surtout quand il entreprend de s’occuper de mon avant-bras.
Et puis la douleur s’estompe un peu. Ils ont probablement mis quelque chose dans la perfusion. Je reste là toute la nuit. Dans ce petit lit des urgences. Quelqu’un a dit qu’il fallait m’opérer en urgence, apparemment l’urgence peut attendre le matin. Mon sang a abondamment coulé sur le matelas imperméable, y formant une flaque coagulée dans laquelle je passe cette nuit infernale. La sensation est horrible. Le bruit de l’accouplement peau, sang coagulé, revêtement synthétique est insoutenable. L’odeur du sang me donne la nausée.
Et puis j’ai froid, ma mère, j’ai si froid.
J’attends avec impatience le jour, j’attends avec impatience le soleil qui viendra balayer ce cauchemar éveillé.
C’était effectivement un cauchemar, mais ce que j’ignorais, c’est qu’il ne faisait que commencer.
A suivre…
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique FRANCAISCAMER
Les + récents
HOMMAGE de Shanda Tonme Au Général Camille Nkoa Atenga
La mort tragique d'un jeune colonel émeut l'opinion
Affaire de scanning au port de Douala : Où est passée la SGS ?
KC-135 américain : crash en Irak en pleine opération contre l'Iran
Monique Koumatekel : 10 ans après, des héros anonymes refont son tombeau pour ne pas oublier
FRANCAISCAMER :: les + lus


NOS ETUDIANTES SONT AUSSI DES PROSTITUÉES
- 18 May 2016
- /
- 84550


Les Camerounais(e)s et le ..., c’est grave !
- 22 September 2018
- /
- 68986

LE DéBAT




Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 230991

Vidéo de la semaine
évènement