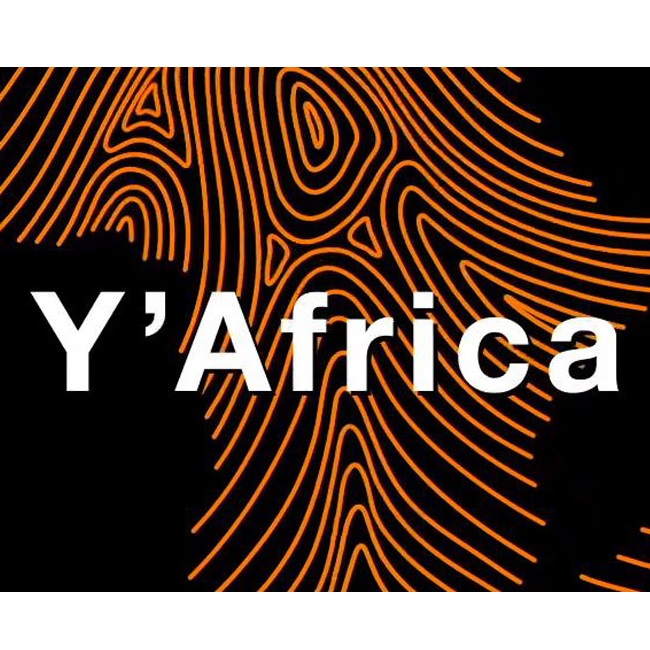-
© Lemonde.fr : Maria Malagardis
- 21 Jul 2018 09:25:26
- |
- 5659
- |
Internet, unique témoin de l'horreur au Cameroun :: CAMEROON
Des vidéos d’exécutions, dont une montrant des femmes et des enfants, circulent sur les réseaux sociaux. Des atrocités attribuées aux militaires et miliciens dans un pays en lutte contre Boko Haram et une rébellion. Pas de quoi inquiéter le président Paul Biya pour sa réélection.
C’est une vidéo insoutenable. On assiste en direct à l’exécution de deux femmes et des enfants qui les accompagnent : un bébé porté dans le dos de l’une, et une fillette qui tient la main de l’autre. Les femmes sont d’abord poussées sur une route et malmenées par un groupe de militaires, suivis au loin par des civils munis parfois de bâtons ou de machettes. Elles marchent et les soldats les brutalisent, les injurient en les accusant d’être des «BH» : des membres de Boko Haram, une secte jihadiste qui sème la terreur dans le nord du Nigeria depuis près de dix ans, mais mène aussi des incursions sanglantes dans les pays voisins. Niger, Tchad et surtout Cameroun, qui a été dès le départ associé à cette vidéo, une fois diffusée sur les réseaux sociaux le 10 juillet.
«Tu vas mourir», gronde un militaire, en tapant sur la tête d’une des femmes. Menace vite suivie d’effets : au pied d’un petit monticule arboré, la cohorte s’arrête. Les militaires forcent les victimes à s’agenouiller, on leur bande les yeux, puis les militaires tirent à plusieurs reprises, s’acharnent même sur les corps inertes. «C’est une vidéo très choquante. A ma connaissance, c’est la première fois qu’on filme une exécution de femmes et d’enfants au Cameroun. Et surtout d’aussi près : on distingue bien le visage du bébé, on imagine la peur de la fillette qui doit comprendre ce qui se passe», soupire Ilaria Allegrozzi, chercheuse pour Amnesty International. Dès que cette vidéo a été mise en ligne, devenant immédiatement virale, l’ONG de défense des droits de l’homme a tenté d’en identifier le lieu et les protagonistes.
Sentiment d’impunité totale
Au Cameroun aussi, des militants des droits de l’homme et des journalistes se sont efforcés de rassembler les pièces à conviction de ce puzzle macabre. En une semaine, les uns et les autres ont amorcé quelques pistes qui contredisent les démentis du gouvernement. Lequel s’était empressé de dénoncer une «fake news», tout en annonçant l’ouverture d’une enquête. Premier constat, contrairement à ce qu’ont affirmé les autorités, la scène semble bien avoir été filmée au Cameroun. Et même très certainement dans l’extrême nord du pays, dans le département du Mayo-Tsanaga, où se trouve une importante base militaire. L’accent des militaires, qui parlent français, a été unanimement identifié comme camerounais. Le paysage sahélien parsemé de petits monticules rocheux est typique de cette zone frontalière avec le Nigeria. Deuxième constat, qui là encore réfute les arguments officiels : il s’agit de militaires, les uniformes bariolés et surtout les armes font partie des tenues et de l’arsenal de l’armée camerounaise, comme l’a détaillé Amnesty International dans un communiqué le 12 juillet. Mieux encore, trois des protagonistes auraient été identifiés, notamment via leurs profils Facebook. Où l’un d’eux affiche un surnom par lequel il est interpellé dans la vidéo.
Jeudi, l’agence Reuters affirmait que quatre militaires auraient été placés aux arrêts, même si cette information reste à confirmer. Selon plusieurs sources locales contactées à Yaoundé par Libération, les militaires de la vidéo feraient partie des fusiliers de l’armée de l’air, une unité déployée dans le Mayo-Tsanaga. Quant aux civils armés, ils font vraisemblablement partie de comités de vigilance mis en place dans cette zone de l’extrême nord.
De quand date la vidéo ? Sur ce point, personne n’a encore de certitudes, mais certains n’hésitent pas à la faire remonter à la période 2014-2016, lorsque les villages frontaliers n’avaient pas encore été vidés d’une partie de leurs habitants, déplacés depuis vers les centres urbains. Comme le village de Mabass, qui était alors au cœur des tensions entre forces régulières et insurgés. C’est dans cette localité qu’en janvier 2015 Boko Haram a enlévé une soixantaine d’habitants, surtout des femmes et des enfants, avant de repartir au Nigeria. A l’époque, c’était le plus important rapt jamais perpétré dans cette région par les jihadistes. La scène de l’exécution des deux femmes visiblement désignées comme suspectes serait-elle liée à ces attaques ? Impossible de l’affirmer dans l’immédiat. Mais la spontanéité avec laquelle les militaires filment leurs propres exactions témoigne d’un sentiment d’impunité totale. «En réalité, au Cameroun, les militaires filment souvent leurs agissements. Ils se les partagent sur des groupes privés comme WhatsApp, jusqu’au jour où certaines de ces vidéos fuitent vers l’extérieur», précise la chercheuse d’Amnesty.
Les ONG des droits de l’homme ont publié ces dernières années de nombreux rapports qui soulignent que même si la lutte contre Boko Haram est justifiée, elle se fait au prix d’un nombre incalculable d’arrestations arbitraires, de tortures, voire de meurtres. Il y a près de deux ans, en utilisant les outils de modélisation virtuelle, mais surtout d’innombrables photos et vidéos publiées par des militaires camerounais sur les réseaux sociaux, dont Facebook, Amnesty avait réussi à reconstituer en 3D deux bases militaires qui ont servi de centres de détention et de tortures dans le nord du Cameroun.
Mieux encore, les chercheurs ont pu démontrer que des militaires américains se trouvaient au même moment sur ces bases. L’affaire a été prise suffisamment au sérieux pour qu’Africom, le commandement des Etats-Unis pour l’Afrique, déclenche une enquête. Dont les conclusions fin 2017 sont pourtant restées jusqu’à présent classées «secret défense». Au Cameroun, la guerre contre Boko Haram se déroule très loin de Yaoundé et de Douala, les deux principales villes du pays. «Jusqu’à la vidéo de l’exécution des femmes, les Camerounais restaient globalement indifférents aux abus commis dans la lutte contre Boko Haram, considérée comme une guerre juste», rappelle Ilaria Allegrozzi.
Villages brûlés dans l’Ouest
Mais le pays est confronté à une autre guerre secrète, celle-là bien plus proche de Yaoundé et Douala. Elle se déroule également à huis clos, et là encore la violence qu’elle engendre resurgit surtout sur les réseaux sociaux. C’est même parfois la seule façon de savoir ce qui se passe dans les deux provinces anglophones de l’ouest du pays, qui se sont embrasées fin 2017. Une guérilla devenue sanglante, résultat d’années de frustrations et de répression qui ont fait basculer une partie de la minorité anglophone dans la lutte armée. En moins d’un an, plus de 160 000 personnes ont fui leurs maisons, pour se cacher dans les forêts de la région, comme des bêtes traquées. Villages brûlés, assassinats, tortures, décapitations : chaque camp, gouvernemental comme rebelle, utilise les réseaux sociaux pour dénoncer l’adversaire. Deux jours après la mise en ligne de la vidéo sur l’exécution dans le nord du pays, les réseaux proches de la minorité anglophone diffusaient abondamment des images brutales de nouvelles tueries attribuées aux forces de l’ordre, dans l’ouest cette fois-ci. Là encore, les autorités dénoncent des «fake news». En revanche, elles n’avaient pas hésité à accréditer des images douteuses.
Fin juin, une vidéo effrayante censée montrer de supposés anglophones cuisinant dans une marmite des restes humains a été largement exploitée pour assimiler les insurgés à des cannibales. Vérification faite, il s’agissait d’une scène de tournage d’un film nigérian. «Reste que le ministre qui a dénoncé ce cannibalisme à la télévision n’a jamais fait amende honorable», rappelle un enseignant joint au téléphone à Yaoundé et qui préfère rester anonyme. Ce qui ne l’empêche pas de se moquer d’une «propagande officielle grossière, qui nie les exactions, nie même l’aggravation de la guerre dans l’ouest alors que la zone des affrontements s’étend et se rapproche de plus en plus de Douala». Allusion aux combats qui se sont déroulés pour la première fois la semaine dernière dans les petites villes de Buéa et de Limbé, à moins d’une heure de la capitale économique du pays. Le 12 juillet, le convoi du ministre de la Défense n’a pas été épargné par les tirs, sur la route de Kumba, dans ce sud-ouest de plus en plus incontrôlable.
Dans ce contexte de violence croissante, qui rejaillit sur les réseaux sociaux, c’est par un simple tweet que le président Paul Biya a cru bon d’annoncer le 13 juillet qu’il se représenterait à un septième mandat lors des prochaines élections fixées au 7 octobre. «Voilà un président moderne, et même futuriste !» s’est emballé l’un de ses proches sur les ondes de RFI. Au pouvoir depuis 1982, Biya, âgé de 85 ans, affirme «répondre aux appels pressants» de ses compatriotes. «Mais les appels de qui ? En trente-six ans de règne sans partage, il n’a rien fait pour le développement de son pays. Il vit la moitié de l’année à Genève», s’indigne à Yaoundé une militante anti-Biya. Mais l’opposition est divisée et affaiblie. Et Biya pourrait bien remporter ce scrutin à un seul tour, précédé d’une campagne électorale très courte. «Sa candidature et sa probable réélection sont une catastrophe et vont renforcer la détermination des anglophones, le pays est au bord d’un soulèvement généralisé. Tout le monde a peur», affirme un homme d’affaires joint à Douala. Et chaque jour sur Twitter ou Facebook, de nouvelles images et vidéos révèlent les violences en cours et renforcent ce climat de peur.
Lire aussi dans la rubrique POINT DE VUE
Les + récents
La justice ordonne l'expulsion immédiate du port de Douala des immeubles de l'ex- Onpc
ENQUETE: DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE ET INNOVATION EN AFRIQUE
Zoom sur les technologies de l’énergie solaire thermique
Y’Africa, le magazine TV des talents africains : Orange annonce une troisième saison ...
Crise au PCRN: Robert Kona Affiche Son Soutien au RDPC
POINT DE VUE :: les + lus





Cameroun,33 ans de pouvoir: Les 33 péchés de Paul Biya
- 10 November 2015
- /
- 100520
LE DéBAT




Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 162219

Vidéo de la semaine
évènement